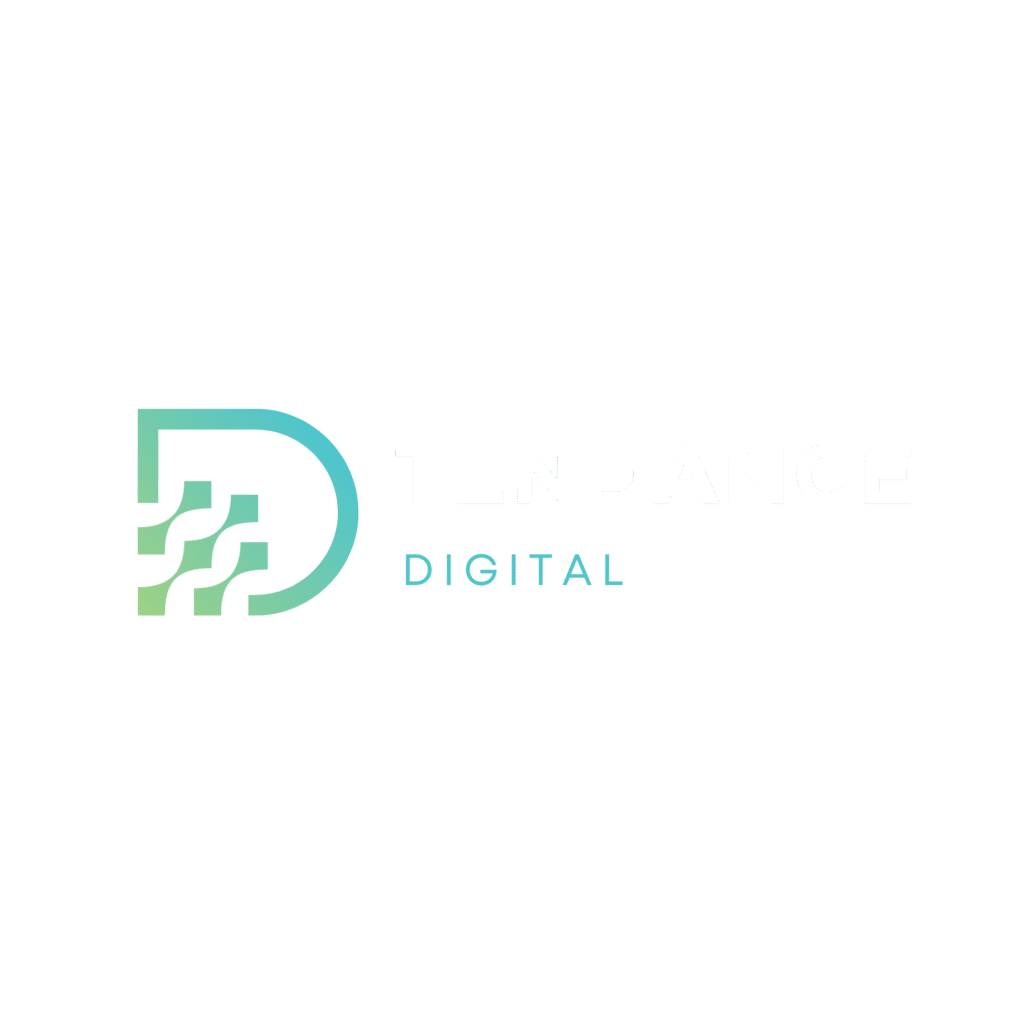TikTok au Sahel n’est plus une simple application de divertissement.
De Bamako à Ouagadougou en passant par Niamey ou N’Djamena, la plateforme est devenue un espace d’expression, d’influence et parfois… de manipulation. Face à une jeunesse hyperconnectée et à une instabilité politique persistante, TikTok s’impose comme un acteur numérique de plus en plus puissant.
Mais cette puissance est-elle au service de la citoyenneté ou de la désinformation ?
Décryptage d’un outil à double tranchant.
1. Une montée en puissance dans un contexte instable
La montée de TikTok dans les pays du Sahel s’inscrit dans un contexte particulier :
-
Crises politiques et transitions militaires
-
Instabilité sécuritaire chronique
-
Méfiance envers les médias traditionnels
-
Fort taux de jeunesse et d’utilisation mobile
Résultat : TikTok devient la “télé des jeunes”, avec des contenus ultra-viraux, souvent émotionnels et peu filtrés.
2. Un espace d’expression populaire… et parfois contestataire
Sur TikTok, de nombreux jeunes sahéliens prennent la parole :
-
Pour dénoncer la corruption
-
Pour commenter l’actualité politique locale ou internationale
-
Pour valoriser l’identité culturelle ou militaire
-
Pour critiquer les puissances étrangères ou les décisions gouvernementales
C’est un outil de mobilisation, de storytelling citoyen, et de création de récits alternatifs.
3. Le revers : terrain fertile pour la désinformation
La viralité de TikTok au Sahel facilite la propagation de récits sensationnalistes, souvent non vérifiés, qui touchent massivement une jeunesse en quête de repères
Beaucoup de contenus reposent sur :
-
Des images sorties de leur contexte
-
Des montages trompeurs ou sensationnalistes
-
Des narratifs simplifiés, voire manipulés
Certains comptes propagent activement de la propagande, du conspirationnisme ou des appels à la violence, souvent sans modération efficace.
4. Influence ou manipulation : où tracer la ligne ?
La difficulté, c’est de distinguer :
-
Une prise de position légitime d’un citoyen…
-
D’une manipulation algorithmique qui survalorise les contenus les plus clivants
TikTok, avec son algorithme opaque, tend à favoriser les émotions fortes, les oppositions frontales et les récits viraux. Cela peut encourager la polarisation, voire la radicalisation.
5. Vers un encadrement ou une appropriation responsable ?
Face aux dérives, plusieurs réponses possibles :
-
Former les jeunes à l’esprit critique et à l’éducation aux médias
-
Encourager les créateurs responsables
-
Mettre en place des politiques de modération adaptées aux contextes africains
-
Promouvoir un usage citoyen, informé et créatif de la plateforme
TikTok ne disparaîtra pas. Il s’agit donc de mieux l’encadrer… ou de mieux s’en servir.
Conclusion : TikTok, miroir numérique du Sahel
TikTok reflète la complexité des sociétés sahéliennes : une jeunesse bouillonnante, des tensions géopolitiques, un besoin d’expression, mais aussi des vulnérabilités face à l’information.
Entre désinformation et mobilisation citoyenne, cette plateforme est un miroir numérique à double face.
Ce n’est pas l’outil qui est bon ou mauvais — c’est ce qu’on en fait.